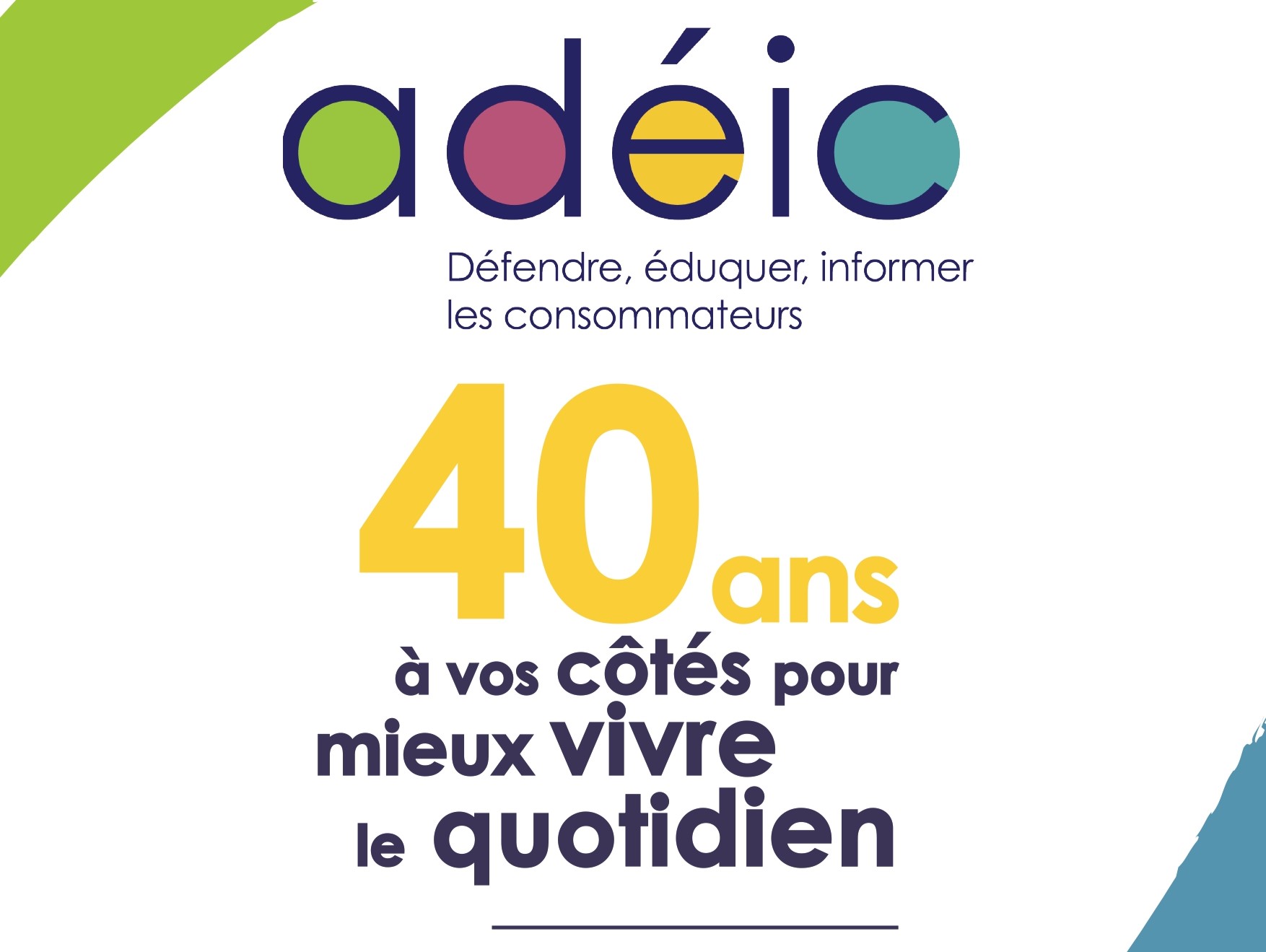Logement insalubre : comment le définir et y remédier ?
Le mal logement est une problématique qui toucherait 4,2 millions de personnes en France en 2024. L’insalubrité est une des situations caractérisant ce mal logement.
L’insalubrité, la non-décence, le péril bâtimentaire/l’insécurité des équipements communs, le local impropre à l’habitation sont des notions qui correspondent à des logements dont l’état de dégradation présente un danger, plus ou moins grave.
Il est important de bien caractériser l’état du logement afin d’utiliser la procédure adéquate pour faire cesser le désordre. Nous nous concentrerons dans cet article sur l’insalubrité du logement.
Qu’est-ce qu’un logement insalubre ?
Selon l’article L1331-22 du code de la santé publique, « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ».
Succinctement, un logement est insalubre s’il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
Par exemple, la mauvaise qualité ou dégradation des structures du bâtiment (murs, planchers, fondations) ; un défaut d’étanchéité, des équipements électriques défaillants/dangereux, la présence de plomb dans une quantité supérieure aux seuils autorisés, ou celle d’amiante, etc.
La présence d’humidité à un taux important dans le logement peut être la conséquence d’un défaut d’étanchéité et d’une aération défaillante. Cette humidité, et la présence de moisissures qui en découle, provoquent ou aggravent des maladies respiratoires.
Que faire en cas d’insalubrité constatée ?
- La première démarche que doit faire le locataire qui occupe un logement insalubre est d’informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception de l’état dégradé du logement, en précisant les défauts constatés dans le logement constituant l’insalubrité, les travaux à réaliser et leurs délais.
- Sans réponse du propriétaire, le locataire doit alors se rapprocher soit du service communal d’hygiène et de santé de sa mairie soit en l’absence de ce service, de l’agence régionale de santé (ARS). A Paris, le service technique de l’habitat reçoit et instruit les signalements d’insalubrité, de sécurité, de péril dans les immeubles et les logements. Le signalement peut être fait en ligne.
- Après ce signalement, une visite du logement aura lieu et son état sera évalué. Une liste de critères permettra de caractériser l’état d’insalubrité du logement. La présence d’un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes est aussi recherchée. Cela aboutira à l’établissement d’un rapport de situation.
- Si le rapport de situation conclut que le logement n’est pas insalubre mais qu’il y a des manquements au règlement sanitaire départemental, le dossier est transmis au maire. Celui-ci sera chargé de faire réaliser les travaux de mise aux normes.
- Si le rapport de situation conclut à l’insalubrité du logement, le préfet est saisi et il informe le propriétaire du logement des désordres. Une procédure contradictoire est mise en place avec le propriétaire qui exécutera les mesures de mise aux normes sauf en cas de danger imminent.
- Le préfet prendra ensuite un arrêté d’insalubrité soit remédiable soit irrémédiable.
- Cet arrêt est irrémédiable s’il n’y a pas de moyen technique pour remédier à l’état d’insalubrité ou si la mise aux normes est d’un coût plus important que la reconstruction du logement.
- Cet arrêt est remédiable si des moyens techniques peuvent mettre fin à l’état d’insalubrité. Le propriétaire sera tenu de faire réaliser les travaux dans les délais indiqués dans l’arrêté. A défaut, le préfet peut ordonner l’exécution d’office des mesures. Le propriétaire peut être contraint de payer une astreinte. Il peut être condamné à une peine d’emprisonnement ou une amende.
- L’arrêté d’insalubrité aura pour conséquence la suspension des loyers pendant la durée des travaux en cas d’insalubrité remédiable et sans limite de durée en cas d’insalubrité irrémédiable.
Si l’interdiction d’habiter le logement est provisoire, le locataire aura droit à un hébergement provisoire aux frais du propriétaire et si l’interdiction d’habiter le logement est définitive, le locataire doit se voir proposer des offres de relogement.
A savoir : si vous êtes locataire d’un logement social, vous pouvez également faire appel à nous, en collaboration avec la FLC (Fédération Logement Consommation), pour vous défendre auprès des bailleurs sociaux (voir notre article sur le sujet)