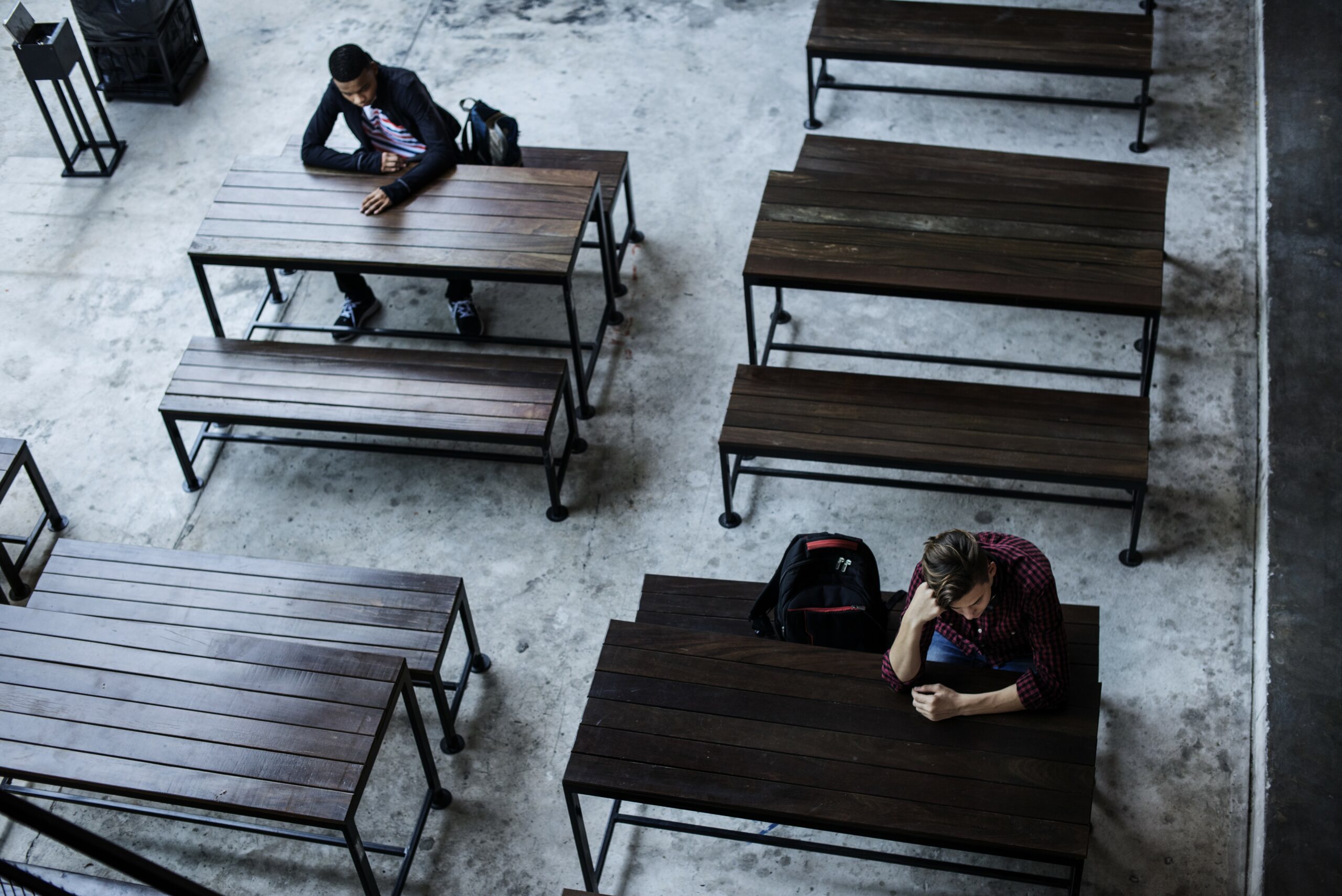Ateliers de sensibilisation à la consommation durable : une première expérience prometteuse !
Depuis novembre dernier, notre union l’ACLC (nouvelle appellation de l’ULCC depuis février 2025) travaille à la mise en place d’une série d’ateliers de sensibilisation à la consommation durable, auprès de publics de tous âges et dans plusieurs villes, dans le cadre d’un projet financé par la DGCCRF. Après une série de colloques destinés à nos bénévoles, où nous avons traité de la consommation durable et plus spécifiquement du gaspillage alimentaire, de l’impact du numérique et du textile sur l’environnement, les premiers ateliers pour enfants et pour adultes ont été lancés, à Evry-Courouronnes et à Nantes. Retour sur ces premières journées d’échange.
L’objectif de l’ACLC est de suivre sur une série de 5 séances des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes, que nous nous engageons à sensibiliser aux pratiques de consommation durable dans plusieurs domaines de la vie quotidienne.
Nous tenions à ce que ces ateliers soient accessibles à tous, en Île-de-France comme en régions, dans des quartiers de centre-ville comme en périphérie. Nos premières interventions se sont donc déroulées à la Maison de Quartier Gisèle Halimi, d’Evry-Courcouronnes, avec un public adulte et enfant issu de cette ville populaire.
Des ateliers pour enfants et adultes
Nous avons d’abord rencontré un groupe d’adultes et un groupe d’enfants, en présence d’une psychosociologue, afin de les écouter sur leurs habitudes de consommation et ce qu’ils et elles entendaient par « consommation durable ». Ces « focus-groupes » adaptés selon l’âge des publics, ont fait émerger des discussions intéressantes sur le tout-jetable, le gaspillage, la surconsommation, et les a priori que nous pouvons avoir, notamment sur les vêtements de seconde main. Sans vouloir donner des leçons, nous avons plutôt cherché à aiguiser la curiosité de ces publics sur les pratiques de consommation durable et les moyens d’y parvenir.
Pour notre deuxième intervention, des ateliers étaient proposés sur le gaspillage alimentaire. Les enfants ont participé à un quiz en équipes, et à un jeu sur la meilleure manière de conserver les aliments, tandis que le groupe d’adultes a réfléchi aux situations où s’effectuait le gaspillage, de l’achat à la préparation des repas. Ces ateliers coopératifs et ludiques ont permis aux participants d’associer la consommation durable à leur quotidien, l’idée étant qu’ils puissent ramener chez eux certaines questions et certains changements.
Un premier bilan enthousiasmant
Pour Flora Strodeur, animatrice de l’association Evolusciences, avec qui nous coopérons pour le groupe enfants, ces ateliers s’intègrent à un travail plus large de sensibilisation au développement durable. D’après elle « cet atelier est une expérience de collaboration très intéressante : l’ADEIC apporte des connaissances et des outils, nous apportons de la pédagogie autour du public enfant ». Elle précise que si les enfants avaient entendu parler de termes comme « consommation durable » ou « gaspillage alimentaire », ils « ne comprenaient pas toujours de quoi il s’agissait ou ce que cela impliquait ». L’atelier s’est alors efforcé de rendre ces enjeux plus accessible et d’« aborder les notions sous un angle que les enfants peuvent comprendre : par exemple, en les reliant à des expériences de leur quotidien ».
Nous sommes heureux de constater que les participants ont répondu avec enthousiasme à nos propositions d’ateliers, et espérons que les prochains rendez-vous susciteront autant de motivation et de réflexions. Des rencontres entre l’ACLC et d’autres groupes d’enfants, ados et adultes sont prévus à Nantes, à Lyon à Dijon et à Marseille. De quoi susciter, nous l’espérons, des envies de consommer plus durablement à travers tout le territoire !